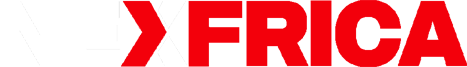ENTRETIEN. Le journaliste et réalisateur présentera au Fespaco son documentaire « Thomas Sankara, l’humain », un travail minutieux et original sur la révolution burkinabè.
Àenviron trois semaines du clap d’ouverture de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), Richard Tiéné, journaliste, réalisateur et producteur de 44 ans, donne les derniers coups de ciseaux à son biopic consacré au « Che » africain. Intitulé « Thomas Sankara, l’humain », ce documentaire a été sélectionné dans la nouvelle catégorie Section Burkina. Elle récompense des œuvres « représentatives du paysage cinématographique burkinabè ».
Résultant de sept ans de travail et autoproduit, ce film 100 % made in Burkina Faso nous transporte des routes cabossées menant au village natal du révolutionnaire burkinabè jusqu’aux recoins glauques et froids – filmés en noir et blanc – du bâtiment où il fut exécuté avec douze de ses compagnons à Ouagadougou le 15 octobre 1987. Une version « grand format » de 2 h 30 avait été présentée au public burkinabé en octobre 2020. Cette nouvelle mouture de 80 minutes en est à la fois un condensé, et pourrait constituer le « teaser » d’un projet de série d’une dizaine d’épisodes de 26 minutes.
La matière est là. Richard Tiéné exhume et accumule depuis des années des archives, publiques et privées, sur Thomas Sankara. Il a rencontré ses compagnons de route, sa famille, des acteurs politiques ou diplomatiques, et aussi des contempteurs de la révolution. Ni une hagiographie ni un dénigrement de cette icône qui « fascine » le réalisateur depuis l’enfance, le documentaire Thomas Sankara, l’humain entend poser un regard équilibré sur ce héros national. Le Point Afrique l’a rencontré dans les locaux de sa société de production audiovisuelle, Gcom.
Vous aviez 10 ans lorsque Thomas Sankara est arrivé au pouvoir. Quels souvenirs avez-vous gardés de la période révolutionnaire ?
Richard Tiéné : Je suis arrivé au Burkina Faso deux ans après son assassinat survenu le 15 octobre 1987. Pendant la révolution, j’étais en Côte d’Ivoire, à l’école primaire. Mais déjà enfant, j’étais subjugué. Je voyais ce Monsieur en treillis, poing levé. Avec des camarades de classe burkinabè, on disait : « Notre président est plus jeune et plus beau que le président ivoirien Houphouët-Boigny » (rires). Et puis j’entendais parler des trois luttes, contre la coupe du bois, la divagation des animaux, les feux de brousse. C’était nouveau. J’ai eu envie de comprendre. Ma mère tenait une mercerie et m’envoyait acheter des journaux pour emballer les articles de couture. Je dévorais les articles qui parlaient de lui dans la presse ivoirienne, et chacune de ses interviews.
Arrivé au Burkina Faso, j’ai vécu un bout de la « rectification » engagée par Blaise Compaoré. Durant mon année de cm2, j’ai fait partie des derniers pionniers de la révolution. On portait encore l’écharpe, le foulard et le béret, juste avant que ces symboles ne disparaissent. J’étais délégué de classe et quand un invité se présentait, le délégué tapait du poing sur la table. Toute la classe se mettait debout et déclamait : « Pionnier ! Oser, lutter, savoir, vaincre, vivre en révolutionnaire, mourir en révolutionnaire, les armes à la main ! La patrie ou la mort, nous vaincrons ! » L’invité répondait « Merci camarade », puis on s’asseyait.
Dans mon village, en tant que pionniers, on avait aussi animé la première édition du festival des masques traditionnels de Pouni. J’aimais cet esprit, mais il n’a pas soufflé très longtemps à travers le pays. Quand je suis entré au collège, en 1990, on ne parlait plus de révolution, c’était fini.
Certaines actions nées durant la révolution perduraient-elles néanmoins ?
Oui, comme la plantation d’arbres. Pendant la révolution, le programme « un village, un bosquet » avait été mis en œuvre, avec le slogan « 8 000 villages, 8 000 forêts ». Les gens continuent aujourd’hui de planter des arbres, c’est un héritage de la révolution. Je me souviens qu’à l’école, on avait aussi des jardins éducatifs. On devait semer, arroser et récolter des produits, comme du chou, des tomates, qu’on retrouvait dans nos repas.
Comment l’idée de ce film a-t-elle germé ?
Ce film sur Sankara, c’est toute ma vie. Au collège, j’ai commencé à lire tout ce qui était disponible sur Thomas Sankara. J’étais fasciné. Chaque 15 octobre, je me rendais au cimetière de Dagnoën, où il était censé être enterré. Les sankaristes et les proches des victimes de l’assassinat de 1987 s’y retrouvaient. Et puis, en 1998, le journaliste Norbert Zongo a été à son tour assassiné. On a dit que c’était le crime de trop. J’étais en terminale à l’époque, et ça m’a beaucoup marqué, car j’aimais ses enquêtes, ses éditos, son style cru. Peu après, je me suis orienté vers le journalisme. Et j’ai toujours gardé à l’esprit ce que Thomas Sankara disait sur ce métier, qu’il fallait dénoncer et dire, au service du peuple, ne pas rester muet, ne pas se laisser corrompre. Et puis je lui ai consacré de nombreux sujets pour la radio. Sankara a toujours été présent dans mon parcours.
Ce film, c’est toute ma vie, aussi car j’ai mis du temps pour le boucler – plus de sept ans ! –, et parce que la réalisation est rythmée d’ingrédients dont je suis fan. Le slam, le rap, la danse contemporaine…
La narration est en effet entrecoupée d’extraits d’un spectacle de danse qui met en scène cinq officiers en treillis et rangers…
Oui, je ne voulais pas me cantonner à dérouler des témoignages sur Sankara. Une création de danse contemporaine a donc été conçue pour ce film. La bande-son est un slam de l’artiste Nathanael Minougou. Il retrace la vie du révolutionnaire, du premier cri du nourrisson jusqu’au dernier souffle du capitaine, avec en toile de fond une certaine tension, et une métaphore sur le poisson capitaine en eaux troubles, confronté aux prédateurs.
Sur la base de ce slam, les danseurs du Centre de développement chorégraphique La Termitière (CDC) ont élaboré une chorégraphie. Les répétitions et la captation vidéo du spectacle ont été organisées dans nos locaux. On a créé une ambiance très obscure, avec des fumigènes, et c’est le réalisateur de vidéo-clips Raywox Mensa qui l’a restituée. Les chants et la musique qui composent la bande-son du film sont quant à eux signés Mai Lengani, Nael Melerd, Ro Bayala et Asley.
Un film 100 % burkinabè, fidèle à la doctrine révolutionnaire du « produire et consommer burkinabè » ?
Oui, et c’est un documentaire entièrement autoproduit, sur fonds propres. D’où le temps passé ! Chemin faisant, je me suis demandé combien de Burkinabè avaient réalisé des films sur Thomas Sankara. J’ai constaté que la filmographie existante se composait essentiellement de documentaires produits à l’extérieur. Peut-être parce que les réalisateurs burkinabè avaient peur d’aborder ce sujet sous le régime de Blaise Compaoré. Personnellement, j’ai eu la chance de terminer ce film alors qu’il n’était plus au pouvoir. N’oublions pas que les établissements publics baptisés « Thomas Sankara » sont récents au Burkina Faso.
Quelle est l’intention de ce film ?
Il s’intitule Thomas Sankara, l’humain. « Humain », cela signifie à mes yeux « affable », « disponible », « accessible », mais aussi « faillible ». Il a commis des erreurs, et je ne voulais pas occulter cet aspect-là. Les documentaires existants, de très bonne facture, n’abordent guère les limites de la révolution, voire ses dérives. Sankara y est plutôt mythifié. Alors que certains accordent beaucoup d’importance à des personnages tels que Chantal Compaoré (épouse franco-ivoirienne de Blaise Compaoré, NDLR), ils font par ailleurs l’économie d’acteurs phares de la période révolutionnaire. Comme le leader politique Soumane Touré (fervent opposant à Thomas Sankara, emprisonné sous la révolution, NDLR) ou Béatrice Damiba, qui fut haut-commissaire et ministre de l’Environnement sous la révolution, puis ministre de l’Information et présidente du Conseil supérieur de la communication sous la présidence de Blaise Compaoré. Ce sont des voix plus critiques de la révolution. J’ai dû les tanner durant des années pour les convaincre de témoigner. Selon eux, à chaque fois qu’ils avaient accepté, leurs propos n’avaient pas été gardés au montage. Des fanatiques de Sankara m’ont reproché d’avoir donné la parole à Soumane Touré, en me disant que c’était « un vieux fou ». Mais j’ai recoupé les chiffres, les dates, et ce qu’il a dit m’a paru pertinent. Selon moi, il est comptable de l’histoire politique de notre pays.
Il s’agit donc d’un film de plus sur Sankara, mais pas d’un film de trop.
Soumane Touré dénonce notamment dans ce film les Comités de défense de la révolution (CDR), qu’il accuse d’avoir « cassé la mobilisation du début », et reproche au Conseil national de la révolution de ne « jamais » avoir souhaité discuter avec les travailleurs…
Soumane Touré, qui est décédé cette année au mois de mars, critique les abus de membres zélés des CDR, qui profitaient du couvre-feu pour outrepasser leurs droits, se croyant tout permis. Thomas Sankara lui-même a reconnu certaines dérives des CDR. De nombreux civils se sont mobilisés pour que la révolution voie le jour, et imaginaient que Sankara leur remettrait ensuite le pouvoir. Soumane Touré, longtemps engagé dans la lutte syndicale, puis politique, fait partie de ceux-là. Mais Sankara est resté arc-bouté sur les chantiers à accomplir, fustigeant les privilèges des fonctionnaires, cette minorité qui buvait du champagne quand une majorité avait besoin d’eau, selon lui. Il entendait donc poursuivre les sacrifices jusqu’à ce que les masses bénéficient des changements.