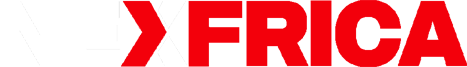Le Festival d’Annecy met à l’honneur la production du continent dans son édition 2021. Un marché livré à la débrouille par manque de soutien public, mais sur lequel misent Netflix et Disney à long terme.
C’est l’une de ses vertus cachées, le lac d’Annecy permet de donner naissance à des films d’animation. Au cours de la 60e édition du Festival international du film d’animation d’Annecy et du Marché international du film d’animation (MIFA), qui se tiennent jusqu’à samedi 19 juin – à la fois en Haute-Savoie et par Zoom, en raison du Covid-19 –, le grand sport consiste à partir à la pêche aux financements. Les réalisateurs s’adonnent à des séances de « pitch » pour lever des fonds.
A la recherche de 500 000 euros pour boucler son budget, mais aussi de coproducteurs, diffuseurs, distributeurs et investisseurs, le cinéaste nigérian Stanlee Ohikhuare a ainsi présenté en ligne, lundi 14 juin, son projet de long-métrage Artifacts. Une histoire de statue en 3D transférée d’une galerie parisienne dans un musée au Nigeria, où elle fait l’objet d’une discrimination de la part de véritables sculptures africaines qui la considèrent comme un vulgaire faux étranger…
Son confrère Brian Olaolu Wilson, également installé au Nigeria, a tenté sa chance pour trouver de l’argent pour sa série Animah’s Journey. Une jeune fille découvre son village à feu et à sang, dans le nord du Nigeria, après une attaque de terroristes de Boko Haram. Animah se cache dans une forêt, y retrouve des amis et veut délivrer des enfants prisonniers.
Plus d’une vingtaine de projets, essentiellement des courts-métrages, émanant de cinéastes africains ont ainsi été présentés. Car, en 2021, le continent africain est à l’honneur au Festival d’Annecy. Un long-métrage nigérian récent, Lady Buckit and the Motley Mopsters, d’Adebisi Adetayo, y a été projeté, afin de montrer ce que Nollywood offre au monde de l’animation.
En six décennies, seuls 46 films africains ont atteint le Graal d’une sélection officielle. Ce qui s’explique aussi par l’extrême rareté de la production de longs-métrages d’animation. « Depuis quinze ans, on ne compte qu’un long-métrage par an. C’est une honte pour un continent de 1,3 milliard d’habitants ! », s’agace Laza Razanajatovo, directeur des Rencontres du film court de Madagascar. Les séries destinées à la télévision tout comme les courts-métrages constituent un marché émergent, même s’il est encore bien trop juste pour alimenter tout le continent. Pour son propre festival, Laza Razanajatovo reçoit, chaque année, « 35 films de courts-métrages d’animation, généralement autoproduits par de jeunes réalisateurs ».
( Le Monde )