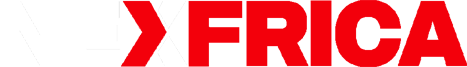Pendant longtemps, il est resté dans l’ombre de son célébrissime élève mort prématurément. Mais depuis quelques années, le grand maître de l’art martial chinois dit wing chun, commence petit à petit à rattraper son manque de notoriété chez nous par rapport à Bruce Lee. Il faut dire que Yip Man est une véritable légende : il a enseigné à moult élèves devenus célèbres dans l’histoire des arts martiaux, et il a surtout grandement contribué à populariser le wing chun dans le monde. Mais il ne faut pas sous-estimer le rôle du cinéma dans la célébrité posthume gagnée par Yip Man (1893-1972).
Parmi tous les films sortis ces dernières années et qui s’intéressent à lui, la saga IP MAN est incontestablement la plus réputée. En quatre films sortis entre 2008 et 2019 et qui racontent chacun un épisode de la vie de Yip Man, le réalisateur hongkongais Wilson Yip a créé un véritable phénomène. En confiant le rôle au génial acteur chinois Donnie Yen – avec qui il avait déjà collaboré sur plusieurs films d’arts martiaux –, le cinéaste a fait de lui une star internationale, puisqu’on l’a depuis retrouvé dans les blockbusters hollywoodiens ROGUE ONE (Gareth Edwards, 2016), XXX: REACTIVATED (D. J. Caruso, 2017) et MULAN (Niki Caro, 2020).

Expert reconnu en arts martiaux, Donnie Yen est évidemment la raison principale de (re)découvrir les films de la saga IP MAN, dont les combats sont toujours restés d’une qualité époustouflante. A contrario de l’exubérance de certaines productions, les scènes d’action des films IP MAN font montre de beaucoup de sérieux et d’un grand respect pour l’art du wing chung. Mais les combattants ont beau ne pas faire n’importe quoi accrochés à des ficelles, ils sont toujours incroyablement fun à regarder : tous les coups sont d’une vélocité folle, et la précision du filmage comme du sound design permettent toujours de ressentir de façon très viscérale leur puissance. Ce résultat est dû d’abord à Sammo Hung, immense spécialiste des chorégraphies de films d’arts martiaux, qui a officié sur IP MAN 1 et 2 et qui a même tenu l’un des rôles principaux dans le deuxième, puisqu’il est aussi à la tête d’une filmographie d’acteur et de réalisateur longue comme le bras.
Pour les épisodes 3 et 4 d’IP MAN Sammo Hung est remplacé par une autre légende des chorégraphies de combats : Yuen Woo-ping, qui a aussi été le mentor de Donnie Yen pour sa carrière au cinéma. À Hollywood, on lui doit entre autres les échanges de coups de la trilogie MATRIX des sœurs Wachowski (1999-2003), ceux des deux volumes de KILL BILL (2003-2004) signés Quentin Tarantino, mais aussi de TIGRE ET DRAGON (Ang Lee, 2000) ou encore de THE GRANDMASTER (2013), le biopic du hongkongais Wong Kar-wai sur… Yip Man. C’est aussi Yuen Woo-ping qui a réalisé le spin-off MASTER Z: IP MAN LEGACY (2018), un épisode sous-estimé où l’on retrouve l’énorme Dave Bautista, après l’apparition d’une autre star américaine des combats dans IP MAN 3 (2015) : Mike Tyson.

Cela saute aux yeux de n’importe quel spectateur : les scénarios des films IP MAN ne cachent pas vraiment leurs messages politiques à la gloire de la Chine. Si nous avons l’habitude de subir quotidiennement le soft power de l’oncle Sam en raison de la domination outrancière des Etats-Unis sur la pop culture mondiale, il est assez intéressant de voir comment la Chine veut se représenter dans son cinéma d’action aux yeux des spectateurs de la planète. Cela passe principalement par le scénario des films, où les méchants venus de nations étrangères sont souvent représentés à gros traits. IP MAN (2008) prend ainsi place pendant la colonisation japonaise de la fin des années 1930, et si le long-métrage a le mérite de montrer les difficultés de la population chinoise pendant cette période, disons aussi qu’il se venge des Japonais via leur représentation.
Dans IP MAN 2 (2010), l’action se déplace avec son héros à Hong Kong, où Yip Man ouvre son école d’arts martiaux quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hong Kong est alors une colonie britannique, et le long-métrage met en évidence la corruption des occupants, ainsi que la façon souvent raciste dont ils traitent le kung-fu et les habitants. Et après le personnage de promoteur immobilier américain cupide joué par Mike Tyson dans IP MAN 3, le dernier épisode sorti l’an dernier enfonce le clou en montrant les discriminations subies par les sino-américains installés à San Francisco en 1964, où se déroule le film. Si l’antagoniste incarné par Scott Adkins est quelque peu caricatural (euphémisme), il n’en demeure pas moins que le racisme antiasiatique dénoncé par le long-métrage reste malheureusement plus que jamais d’actualité aujourd’hui. Terminons sur une note plus positive : les scènes d’action qui font le sel de chacun de ces films ne vieilliront elles heureusement jamais.