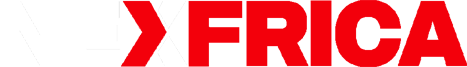Un retour à la forme pour le réalisateur Mahamat-Saleh Haroun, ce film tendu et ravissant rejette le patriarcat de manière de plus en plus inattendue.
« Nous sommes tous frères dans l’islam. Toute personne ayant un problème peut venir parler. » Avec ces mots, un imam local offre un soi-disant réconfort et des conseils à la mère célibataire troublée Amina (Achouackh Abakar Souleymane), ne considérant pas que s’adresser à elle en tant que son “frère” n’est peut-être pas l’invitation la plus accueillante. C’est le moins pour le problème qu’Amina allaite : sa fille de 15 ans, Maria (Rihane Khalil Alio), est enceinte et n’a aucun désir de porter l’enfant. Lorsque, plus tard, une sage-femme aimable déclare qu’Amina est “comme ma sœur maintenant”, ce simple terme d’adresse est comme un nouvel approvisionnement en oxygène. Dans “Lingui”, un bref et paisible nouveau film du réalisateur tchadien vétéran Mahamat-Saleh Haroun, Amina et Maria sont confrontées au monde d’un homme à chaque tournant ; la façon dont elles en sculptent celui d’une femme rend le visionnement surprenant.
Pour Haroun, “Lingui” est un retour en forme (et à la compétition cannoise) après que son dernier long métrage narratif, le drame immigré agréablement grand public mais inoubliable “Une saison en France”, n’a pas réussi à prendre feu. Une fois de plus tourné dans les rues vibrantes et saupoudrées d’ocre de la capitale tchadienne N’Djamena, le cinéaste semble renouvelé, vivant à la texture, au son et à la couleur locaux. L’objectif de Mathieu Giombini est aussi riche et saturé que le lin surteint ; Même dans les scènes les plus douces du film, la conception sonore de Thomas Bouric est une symphonie complexe de voix, de véhicules et de chiens aboyants. Malgré toute sa beauté de surface, cependant, “Lingui” n’échange pas de pictorialisme vide : dès le plan d’ouverture, qui nous présente Amina alors qu’elle dépouille méthodiquement les vieux pneus pour la ferraille, Haroun s’intéresse vivement et vigilant à la façon dont les gens vivent, bien avant que la mécanique plus extrême de l’intrigue ne se lance.
“Lingui” peut ramener son créateur dans un milieu familier, mais c’est un départ passionnant à d’autres égards. Il s’agit du premier film de Haroun axé expressément sur les femmes : c’est peut-être une coïncidence qu’il soit moins stentorien dans son mélodrame que certains de ses travaux précédents, bien que compte tenu du changement, il soit approprié que le film écoute autant qu’il parle. Ses surprises s’étendent à ses choix d’accent et de protagoniste. La prémisse d’une adolescente désespérée d’obtenir un avortement dans un pays hostile au choix peut sembler marquer “Lingui” en tant que sœur d’outre-le-mille de films tels que “4 mois, 3 semaines et 2 jours” et “Jamais rarement parfois toujours”. De façon inattendue, cependant, le film prend la perspective non pas de la fille, mais de sa mère, car le sort de sa fille l’oblige à reconsidérer les règles sociales et religieuses qui n’ont jamais très bien servi l’un ou l’autre d’entre eux.
Dans une performance à la fois contenue et difficilement physique, Souleymane cartographie ces changements de pensée à la fois sur son visage, souvent capturés dans un repos sévère et contemplatif, et dans un langage corporel lentement modifié. Au cours des 87 minutes serrées du film, les épaules d’Amina deviennent carrées et délibérées, sa foulée étant une ligne d’attaque. Ce n’est qu’au début de la trentaine qu’elle semble presque, dans sa démarche délibérée et sa voix craquelée, souvent à bout de souffle, avoir vécu deux fois plus longtemps. Il n’est pas étonnant que Maria voie impitoyablement sa mère comme une mise en garde ambulante : « Je ne veux pas être comme toi, maman », dit-elle, lorsque sa mère essaie de lui convaincre de mener à bien la grossesse. « Tout le monde pense que vous êtes une femme lâche. » Même les jeunes de ce monde ont intériorisé la misogynie conservatrice de leurs aînés.
Si Maria semble un personnage légèrement wan et informe par comparaison, c’est parce qu’elle est beaucoup plus claire sur ce qu’elle ne veut pas dans la vie que sur ce qu’elle fait. Bien sûr, Amina l’a eue à peu près au même âge que Maria est maintenant, et a ensuite été abandonnée par une société dirigée par des hommes qui – à l’exception de la préoccupation sainte de l’imam et des avances sans sentiment d’un voisin âgé – ne la voit guère du tout. Maria, quant à elle, refuse de nommer l’homme qui l’a imprégnée et est expulsée de l’école lorsque les enseignants apprennent son état : Une maternité tout aussi solitaire semble l’attendre si la médecine n’intervient pas. Au-delà des principes religieux qu’Amina récite d’abord, avec peu de conviction, par forme, quelle bonne raison a-t-elle de ne pas soutenir le choix de sa fille ?
Une fois alliées, Amina et Maria découvrent qu’elles sont moins seules qu’elles ne le pensaient : « Lingui » se traduit par « liens sacrés » et se réfère à la communauté tranquille de femmes qu’elles trouvent prêtes à agir dans leur meilleur intérêt, sans jugement ni remontrance ni même argent changer de mains. Le film ne suit pas la piste standard d’un drame à thème parce que, de son point de vue, il n’y a pas de problème à discuter : c’est l’histoire de femmes qui font ce qu’elles doivent faire, même lorsque ces besoins, dans le cas d’Amina, portent le récit assez loin d’une étude de la fraternité bienveillante.
Le cinéma lui-même, quant à lui, centre les femmes à chaque tournant, de sa sélection de plans à sa conception de costumes : rétrospectivement, il est difficile de se souvenir spécifiquement d’un visage masculin de la procédure, tandis que des gros plans éclairés délicieusement composés et sensibles des pistes féminines s’attardent de manière indélébile. Contre le paysage urbain sablonneux et brûlé par le soleil de la périphérie pauvre de N’Djamena, les teintes flamboyantes et les motifs hyperactifs des vêtements des femmes ne servent pas seulement de contraste ornemental, mais signifient une résurgence de la vie et du sentiment. Même les quartiers d’une sage-femme aimable sont peints dans de vastes étendues électriques de cyan et d’outremer : dans “Lingui”, les libertés des femmes sont parfois affirmées en secret, mais elles ne s’estompent pas à l’arrière-plan.